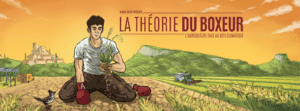Entretien avec Nathanaël Coste, Auteur-Réalisateur et Producteur de La Théorie du Boxeur et de En quête de sens sorti en 2015.
Présentation rapide de l’oeuvre :
“L’agriculture face au défi climatique”, sous titre Nathanaël Coste, le réalisateur du film La Théorie du Boxeur sorti début 2024 et distribué par l’association Kamea Meah. Il a suivi pendant près de deux ans dans la Drôme, des agriculteur.ice.s, des forestiers, des associations et des chercheur.se.s, les interrogeant sur la réalité de leur écosystème, sur les évolutions des sols, de la faune et de la flore, de l’eau et des températures, et sur leurs pratiques pour y répondre. Il dresse un constat sans appel : un bouleversement est à l’œuvre, une crise sans précédent s’installe insidieusement, sourdement, loin des regards, mais si proches des assiettes. Un désastre environnemental est en train de se répercuter sur un des secteurs les plus essentiels : l’agriculture et l’alimentation. Celui-ci a connu de nombreuse mutations, aux fils des ans et des politiques, et s’avère aujourd’hui rattrapé par les transformations du climat, et acculé par sa réalité brutale et catégorique. La théorie du boxeur est héritée d’une image frappante, celle de l’enchaînement trop répété des sécheresses qui fragilise les arbres et leur résilience. Assommés tantôt par des périodes trop sèches voire pire, par des incendies, tantôt par des maladies ou des ravageurs, des forêts entières sont mises au tapis. Le sujet : comprendre la gravité des enjeux agro-écologiques d’aujourd’hui, la dérégulation de la chaleur, des cycles de l’eau et de la biodiversité, puis, réagir, s’adapter, rebondir.
Bande annonce du film
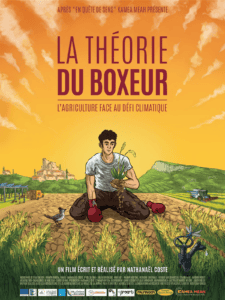
Bonjour Nathanaël, peux-tu nous en dire plus sur toi ? Comment en es-tu arrivé à réaliser ce film La Théorie du Boxeur ?
Depuis plusieurs années, je suis préoccupé par les nombreuses difficultés du monde agricole. Aux difficultés économiques et à la charge de travail s’ajoutent les effets du dérèglement climatique qui nous percutent de plein fouet. Certain·es abandonnent ce métier sinistré, et on déplore en moyenne un suicide d’agriculteur·ice tous les jours en France. La moitié des “chef·fes d’exploitation” va passer la main d’ici 10 ans.
L’agriculture à taille humaine que nous connaissons est menacée, et le dérèglement climatique peut être une opportunité pour faire évoluer le système agro-alimentaire. Avec ce film, j’ai voulu laisser de côté mes aprioris. Explorer comment les agriculteur·ices pourraient faire face au mur du dérèglement climatique, comment nous pourrions développer la résilience alimentaire des territoires.

Qu’est-ce qui vous a motivé à documenter les impacts du dérèglement climatique sur le territoire où vous vivez, la Drôme ?
Depuis 2010, le dérèglement climatique frappe fort avec des vagues de chaleur et des restrictions d’eau de plus en plus fréquentes qui impactent les agriculteur.ice.s. Mon passé de géographe m’a amené à travailler avec des irrigants dans toute la France. J’étais témoin de l’incompréhension croissante de mes ami.e.s au sujet de l’irrigation. C’est assez naturellement que j’ai eu envie d’enquêter dans ma vallée pour comprendre comment le dérèglement climatique était perçu mais surtout quelles adaptations étaient déjà mises en place. Comme décrit dans le film, la vallée de la Drôme a une histoire agricole récente qui s’est construite autour des circuits-courts, de la bio, et d’innovations variées et donc particulièrement résiliantes. Cette vallée “laboratoire” accueille aussi une grande diversité de filières agricoles : grandes cultures, maraîchage, viticulture (la clairette de Die !), arboriculture, élevage ovin, volailles… C’est un terrain idéal pour tenter de comprendre les mutations agricoles en cours.
Justement, quelles adaptations avez-vous trouvé sur le terrain ?
Les modes d’adaptation sont très divers ! Comme l’a écrit la chercheuse Agnès Bergeret qui intervient dans le film, on a d’un côté une réaction qui consiste à essayer de maintenir la productivité et les cultures telle qu’elles sont, en créant des infrastructures comme des stockages d’eau par exemple. La technologie et la génétique occupent une grande place dans ce cas. Une deuxième façon de s’adapter est de modifier certains paramètres de sa production : changer les variétés ou la surface qu’on va cultiver, créer de nouvelles filières (la pistache, la grenade, le sorgho…), économiser les ressources…Et puis, le troisième mode d’action va être d’adapter son mode de production, en cherchant à travailler avec les écosystèmes, en régénérant les sols ou les cycles de l’eau. C’est très certainement un bouquet de solutions qui nous permettra de nous adapter au défi climatique.
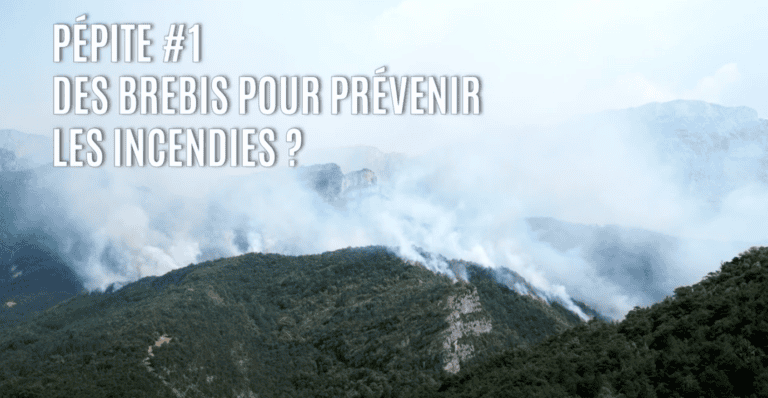
Votre film n’oppose pas les différents types d’agriculture, pourquoi ce choix d’aller donner la parole aux agricultures conventionnelles et bio ?
En France, on a divisé par 4 le nombre d’ agriculteur.ice.s en 40 ans. Ils ne sont plus que 400 000 dont la moitié va prendre sa retraite dans les dix ans à venir. La question de notre avenir agricole se pose plus que jamais. La crise climatique arrive dans un contexte où très peu d’agriculteur.ice.s vivent dignement de leur métier et où le nombre de suicides reste incroyablement haut. Beaucoup d’agriculteur.ice.s souffrent de ne pas être considéré.e.s et reconnu.e.s pour leur travail. Les filières biologiques sont particulièrement en difficulté, mais c’est l’ensemble de l’agriculture qui est aujourd’hui en péril comme en témoigne les protestations agricoles qui ont bloqué le pays en janvier 2024. J’ai voulu m’adresser à tous les types d’agriculture car la question du climat touche tout le monde. Et comme le rappelle le film, ce n’est pas la responsabilité des agriculteur.ice.s si le système agricole est encore largement basé sur l’utilisation de la chimie. Il ne faut pas se tromper de combat, c’est notre dépendance aux firmes de l’agro-industrie qui doit évoluer pour favoriser une plus grande résilience alimentaire et la bonne santé des personnes et des écosystèmes.
J’ai fait le choix d’aller voir des agriculteur·ices en bio et en conventionnel, sur de petites et grandes surfaces, afin de questionner nos croyances en prenant en compte la complexité de ces enjeux. Sur le terrain, les différents modes d’adaptation sont nombreux : basés sur les infrastructures, les technologies, la génétique, les changements de cultures ou le fonctionnement des écosystèmes, ces différentes directions parlent de nos visions du monde qui souvent s‘opposent.
Le film ne cherche pas à opposer ces stratégies mais à décrire leurs fondements et à comprendre les questions sociétales qu’elles soulèvent. Il invite les spectateur·ices à réfléchir par elle·eux-même à la problématique de l’adaptation et à mettre en perspective leurs propres pratiques alimentaires. Les interventions de scientifiques tels que Nicolas Bricas, sociologue, ou Benoît Fontaine, naturaliste, nous aident à expliquer la réalité et le fonctionnement des crises que nous traversons.

Selon vous, quels sont les plus gros défis que devra relever le monde agricole face à l’accélération du changement climatique ?
La crise climatique, nous n’en voyons que le début. La vallée de la Drôme a déjà « pris » entre 1.5 et 2 degrés depuis 1960 et prendrait encore 1,6 degré d’ici 2050. On a du mal à se représenter ces échelles de grandeur, mais c’est incroyablement rapide et dangereux pour les écosystèmes et nos modes de vie. Pour faire face à des sécheresses et des inondations plus fortes et plus fréquentes, il faudra travailler sur la capacité des sols à stocker de l’eau, comme le propose l’hydrologie régénérative. Les vagues de chaleur au-dessus de 37 degrés qui peuvent griller fruits, légumes, et céréales sont un deuxième souci de taille car les rendements sont très affectés. L’agroforesterie peut apporter des réponses en créant de l’ombrage mais c’est aussi l’une des promesses de l’agrivoltaïsme qui dispose des panneaux solaires au-dessus des fruitiers et des prairies. La crise de la biodiversité évoquée dans le film est une autre crise concomitante qui doit nous pousser à revoir nos pratiques en profondeur, sous peine de vivre des printemps silencieux et de ne plus pouvoir assurer la pollinisation des cultures. Finalement le plus gros défi sera surement de réussir à adopter une approche globale et résiliante pour répondre à ces crises et retrouver un équilibre dans un monde où les énergies vont se raréfier.

Stocker de l’eau, est-ce une solution souhaitable ?
La création de grands stockages d’eau pour garantir des volumes d’irrigation est très ancienne et plébiscitée par une partie du monde agricole qui cherche à maintenir ses productions. Pour autant, une partie de la population milite contre ces « bassines » qui pour eux « privatisent » l’eau et ne constituent pas des solutions de long terme résiliantes. La « bataille » autour des retenues d’eau de Sainte Soline cristallise aujourd’hui cet affrontement idéologique autour de différents modèles pour l’agriculture et l’alimentation. Le film tente de tirer les fils pour démêler cet imbroglio.Quand on parle de stockage d’eau, on a localement des retenues collinaires modestes qui peuvent aider à maintenir en activité de petites exploitations. De l’autre, on trouve de grands stockages qui sont liés à des filières longues voire à l’agro- industrie. Le maïs irrigué qui sert pour une bonne part à alimenter du bétail est très souvent pointé du doigt. Très aidé par la politique agricole commune, il est de moins en moins adapté dans le Sud de la France où l’eau se fait de plus en plus rare en été.Stocker de l’eau n’est pas absurde en soi, mais la question de l’échelle de ces stockages, et surtout de l’utilisation de cette eau doit être débattue alors que tous les usages sont en concurrence. La souveraineté alimentaire de la France, en net recul depuis 50 ans, doit être aussi au cœur de ces arbitrages.

Le film donne-t-il des solutions aux citoyen.ne.s pour reprendre la main sur leur alimentation ?
Dans le film, Nicolas Bricas, chercheur au CIRAD plaide pour une “démocratie alimentaire” qui orienterait collectivement notre modèle agro-alimentaire à échelle locale et pourquoi pas nationale. Une première façon de reprendre la main sur l’alimentation c’est de se connecter aux agriculteur.ice.s et de s’intéresser à la manière dont on produit les aliments ! Beaucoup de produits importés qui sont moins chers que les produits français sont traités avec des molécules qui dégradent l’environnement et la santé, et sont interdites ici. Ce double standard, créé une concurrence déloyale qui provoque la colère des producteur.ice.s car les personnes se tournent massivement vers ces produits étrangers. Se nourrir sainement et soutenir les agriculteur.ice.s français.se.s, cela a un coût qui va continuer à augmenter avec les exigences environnementales. Pour répondre aux différentes crises, nous allons devoir accepter de payer notre alimentation plus cher, ce qui pose de très nombreuses questions quand on sait que 3 millions de français.e.s dépendent de l’aide alimentaire ! Face à cela, des expérimentations fleurissent en France pour penser une “Sécurité sociale de l’alimentation” basée sur des principes mutualistes qui maintiennent une agriculture locale rémunératrice et permettre au plus grand nombre d’y accéder quelque soit son niveau de revenu.
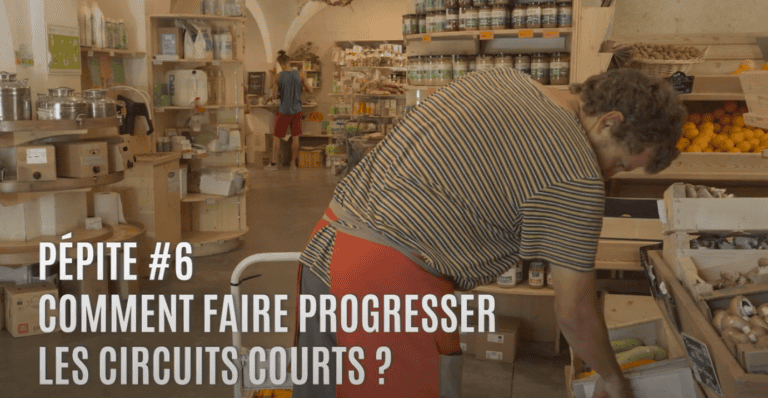
Quelles ont été vos surprises et les défis rencontrés tout au long de ce tournage assez particulier, de la production à la distribution du film ?
Au fur et à mesure du tournage on s’est rendu compte de l’isolement des agriculteurs, peu soutenus et accompagnés, entre temps la TRACC est sortie avec le plan d’adaptation à + 4 C° qui est sorti, sans trop de mesures agricoles concrètes, ni de budget. Les agriculteurs sont livrés à eux même pour expérimenter et tenter des projets comme la pistache dans le sud de la France. Ils sont incroyablement combatifs par rapport à toute la charge mentale que ça représente, à mesure de leur amour pour ce métier. La difficulté pour le film en lui-même, il a la particularité d’être associatif en auto-production et auto-distribution dans un monde du cinéma très concurrentiel, on a enchainé et c’est beaucoup de travail, merci aux équipes de Kaméa Meah d’ailleurs. J’étais étonné de voir que les médias mainstream ne sont pas intéressés, même dans la presse écolo. Même si gravitent les syndicats et les lobby qui interfèrent, il n’y a pas le camp du bien ni le camp du mal, mais les médias donnent presque l’impression d’être insensibles à ces problématiques. En revanche, dans les organisations citoyennes, heureusement il y a eu de l’écho. Deuxième défi : la campagne d’impact du film : chercher des financements est chose ardue, le mécénat c’est compliqué mais les subventions ont été possibles grâce à la fondation Carasso, Pas Cap et Domorrow. On a bataillé pour financer des formations d’intervenant.e.s, pour toucher le monde scolaire, le monde public et le monde agricole qui nous paraissent incontournables pour résoudre collectivement les problématiques du film.

Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?
Après avoir fêté les un an du film, et plus de 50 000 spectateurs, l’objectif est de continuer à faire vivre le débat, d’échanger et de faire naître des réactions et des solutions collectives pour plus de résilience. On voudrait réaliser plus de projections en entreprises et dans des collectivités en faisant intervenir des agriculteur.ice.s, des scientifiques et d’autres acteurs comme Olivier Hamant, en plus du lancement de la saison 2 de notre websérie intitulée Sortir du ring disponible gratuitement sur Youtube. Elle vient compléter le film avec des formats courts pour mettre l’accent sur des solutions existantes et montrer des initiatives locales contribuant à rendre le système plus durable. Ensuite je réfléchis aussi à d’autres projets de représentations, d’évènements ou même de films. On a créé un guide d’animation et formé des gens pour aller animer des projections et entretenir un débat citoyen fructueux. Pour l’éducation nationale on a un dossier pédagogique pour les professeurs, éligible au pass culture, pour permettre aux étudiants de parler de leur situation et de leur donner une idée de ce qui se passe. On voudrait aussi développer la formation pour les élus avec Solagro, financée en partie par Carasso. Le dernier point de développement c’est de toucher plus le monde agricole, qui reste finalement assez loin des salles de cinéma. On voudrait passer par des chambres d’agriculture et des syndicats pour organiser des séances spécialement pour eux, pour en débattre, et pour éviter l’agri-bashing. Après ce film, il s’agit de ne pas baisser les bras !

💡L’avis de FoodBiome :
La Théorie du Boxeur est une invitation non plus à voir le monde comme un ring, qui a guidé nos pratiques à vouloir nous rendre maîtres et possesseurs de la nature, c’est bien au contraire une volonté de changer notre rapport au vivant, d’adopter une approche globale réconciliant la triptyque eau-sol-vivant. La pensée du long terme, de la robustesse et de la résilience pour guider nos actions et panser les plaies du court terme et des changements climatiques. Pour ce changement la complexité est de mise, signifiant une prise en compte globale, aux multiples causes et connexions, et aux solutions imbriquées. Par opposition à la difficulté, qui existe bien, mais qui réside surtout dans les esprits, dans la volonté de changement et de remise en question de pratiques qui ont été institutionnalisées et qui sont aujourd’hui caduques pour donner un avenir au lendemain. Sans chercher à tout optimiser sans cesse et pour absorber mieux les chocs, notre attitude doit glisser d’une lutte et d’une confrontation à une danse, plus agile, plus résiliente et plus robuste… plutôt que de s’opposer, faire corps. C’est très exactement la thèse de Foodbiome, réconcilier l’alimentation et le territoire, dans une dialectique du vivant.
Les annexes que nous recommandons
- Le film est disponible à la location en VOD et prochainement en clé USB.
- La saison 1 de la websérie Sortir du ring donne un bon éclairage sur les solutions concrètes, vous pouvez soutenir sa production.
- Il est possible d’organiser des projections et animations au cinéma, à l’école ou en dehors en les contactant ici
- Une formation réalisée avec Solagro est également possible pour les élus.es et techniciens.nes de collectivités ou services de l’Etat ici
- Lien vers le site du documentaire : https://www.latheorieduboxeur.fr/
Découvrez d’autres de nos publications :