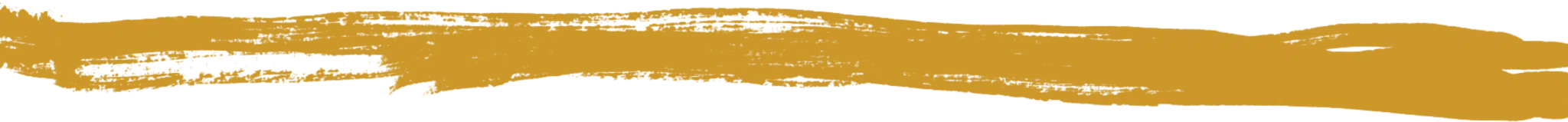Nous sommes à la fin du siècle dernier, ma sœur cadette, Anne, achète avec Herman son époux, une petite pâtisserie de Saint Rémy de Provence : « Le petit duc ». Herman est un bon pâtissier mais surtout sa culture germanique en a fait un biscuitier hors pair. Anne, elle, curieuse de tout, profite des ressources d’une amie archiviste et historienne et se plonge notamment dans les écrits de la célébrité historique locale : Michel de Nostredame dit Nostradamus. C’est dans le « traité des fardements et confitures » dudit qu’elle va inlassablement puiser ses recettes. Des recettes de biscuits principalement car à l’époque, c’était une façon répandue chez les apothicaires de conserver les principes bénéfiques des plantes. Faisons court, sa gamme de biscuit a un succès fou et bientôt il lui faut réaliser que le développement de cette activité ne peut se contenter de la taille modeste du laboratoire du « Petit Duc ». Ce n’est pas un problème de ressources en produits de qualité, c’est un problème de taille de l’outil et de débit.
Elle s’adresse alors à un industriel du biscuit en vue d’externaliser tout ou partie de la production. A la visite de l’usine tout semble épatant, les convoyages, les pétries, les découpes au jet d’eau, les cuissons en tunnel, les conditionnements, tout ça semble présager d’un avenir serein pour la montée en charge de la marque naissante et déjà célèbre du « Petit Duc ». Seulement voilà, léger détail mais pas sans importance, quasiment aucune des recettes mises au point par Anne et Herman ne convient à ce magnifique outil industriel. Après moult tentatives et essais infructueux, il faut se rendre à l’évidence : si on veut profiter des performances « formidables » de cette usine ultramoderne, alors il faut changer le produit. Et pas qu’un peu, jugez-en vous-même : il faut changer les farines (pas assez de gluten) changer les textures des pâtons, changer les corps gras et même modifier la forme de certains biscuits. Bref, il faut que le produit se plie à l’outil. Cet épisode fût pour moi révélateur. J’étais à ce moment-là ce que les guides gastronomiques appellent volontiers un « jeune chef prometteur » dans mon (tout) petit restaurant de Biarritz, l’archétype absolu de l’artisan même si, à l’époque (et encore aujourd’hui) les restaurateurs dépendaient de la chambre de commerce et non de la chambre des métiers.
Cette anecdote me permit au moins d’avoir une réflexion sur le geste industriel et surtout après bien d’autres expériences de conseil dans l’agro-alimentaire, j’ai pu me rendre compte d’une chose qui, aujourd’hui structure ma vision de ce sujet : L’industrie fait ce qu’on lui demande de faire ! Il n’y aurait donc aucun à priori à avoir sur l’industrie en soi mais sans doute devrions nous être vigilants sur l’évaluation globale de ses activités, tout simplement. Il me semble important de dé-corréler la masse des flux de leurs impacts. Ce n’est évidemment pas parce qu’on fait beaucoup que l’on fait mal et l’inverse est aussi vrai. Maintenant que la pluralité des enjeux de tout ce qui touche à l’industrie agro-alimentaire (durabilité, santé, énergie etc..) s’imposent à nous, il est temps de se donner les moyens d’apprécier ce moment de bascule, le moment où l’industrialisation et la massification des processus commence à détruire de la valeur au lieu d’en produire. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser intuitivement, ce n’est pas forcément les progrès techniques et l’automatisation qui en sont la cause.

Alors, comment évaluer cela ?
Quelques points de vigilance peuvent nous y aider :
– A quel moment la volonté de standardiser la production et l’offre rend-elle intolérable la (bio)diversité originelle et nécessaire des denrées agricoles et pousse l’agriculture à des pratiques néfastes ?
-A quel moment, perd-on toute traçabilité de l’origine et des valeurs des produits agricoles dans un approvisionnement fait de mélanges uniformes seuls capables d’alimenter de grosses lignes de production ?
-A quel moment la taylorisation des tâches fait-elle perdre aux acteurs toute vision globale de l’activité, les réduisant à l’état de « machines à produire » ?
-Et enfin, à quel moment l’outil industriel nous oblige-t-il à reformuler les produits et entrer dans la spirale pernicieuse des additifs et de la « cosmétique alimentaire » pour coller à ses impératifs techniques ?
C’est de cette lucidité dont nous avons besoin aujourd’hui pour faire en sorte de traiter au mieux et en conservant leurs valeurs d’origine les produits issus d’une agriculture en pleine évolution. Il y a sûrement un travail à faire sur l’étalonnage de ces échelles sur chacun des points traités plus haut. Il semble clair que l’industrie agro-alimentaire a, aujourd’hui, tout intérêt à revoir la taille de ses outils et mieux distribuer ses activités sur les territoires.
Ce que nous devons prioriser, c’est sans aucun doute la lisibilité de nos pratiques et la capacité de mieux valoriser celles qui vont dans le bon sens. Le fait qu’elles soient privées, publiques, artisanales ou industrielles n’a, en fait, aucune importance.