Entretien avec Jean-Claude Ferron (président actuel) & Emmanuel Oudry (directeur) sur le GIE (Groupement d’Intérêt Economique) Chapeau de Paille, un regroupement de 35 cueillettes créé il y a plus de 40 ans
Bonjour Jean-Claude, Emmanuel, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l’origine et la création du GIE Chapeau de Paille ?
La naissance de ce mouvement a démarré il y a presque 40 ans grâce à un collectif de 5 pionniers, originellement agriculteurs en céréales, à la suite de voyages à l’étranger. Partageant des convictions environnementales et sociales communes, ils décident de renforcer leur activité de cueillette de fraises “libre-service” déjà ébauchée depuis le milieu des années 1970 et de mettre en commun leurs compétences et connaissances en se structurant en GIE. C’est ainsi qu’ouvrent les premières cueillettes en 1985 !
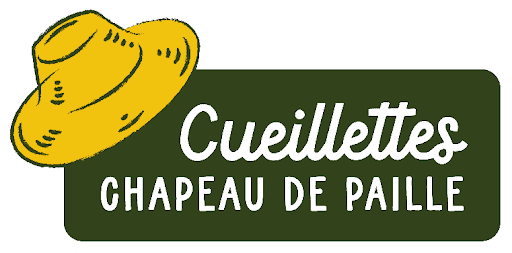
Mais pourquoi un GIE me diras-tu ? En fait, ce statut juridique permet que chaque agriculteur conserve son indépendance tout en bénéficiant des retours d’expérience, des conseils techniques et de l’accompagnement du collectif. Les prises de décision sont faites de manière horizontale : 1 membre = 1 voix.
Aujourd’hui, le GIE Chapeau de Paille est un acteur majeur des circuits-courts de proximité en France. Nous réunissons au total 32 membres propriétaires de 35 cueillettes, allant de 8 à environ 50 ha, situées un peu partout sur le territoire national (Rennes, Reims, Metz, quelques unes en Vendée, 7 en Hauts-de-France, etc.), dont ⅓ se situent en Ile-de-France, là où le mouvement a débuté. Au total, cela représente 550 ha de parcelles cultivant 130 variétés de fleurs, de fruits et de légumes en agriculture durable. L’ensemble de nos cueillettes reçoit 2 millions de cueilleurs chaque année.

Quel est le processus d’adhésion au GIE ? Il y a-t-il un cahier des charges spécifique à respecter ?
Oui, en effet. Toutes les candidatures sont examinées. Le processus d’intégration au GIE dure entre 9 à 12 mois, ce qui permet de structurer et de renforcer le projet de cueillette du futur membre. Ce processus se fait autour de documents contractuels avec des commissions qui ont pour mission de consulter les candidats, d’évaluer la réussite économique et humaine de leur projet et de les accompagner dans sa mise en œuvre. Si cela est probant, nous établissons un contrat d’affiliation de 3 à 4 ans avec le porteur, étape préalable avant qu’il devienne adhérent.
Le cahier des charges pour le dimensionnement d’une cueillette demande aux agriculteurs d’avoir un terrain disponible de minimum 10 ha dont 1 ha de vergers. Il faut être capable de produire une diversité de produits, environ 45 à 50 variétés (fraises, tomates, légumes dits “ratatouille”, etc.), et être ouvert minimum 6 mois dans l’année (7j/7) au public en saison. Globalement, il est nécessaire d’apporter tous les éléments structurels à l’accueil du public : halle, parking, détail du parcours de cueillette, etc. Le GIE n’impose pas d’être en bio, mais les cueillettes doivent pratiquer une agriculture dite “éco-responsable” : par exemple, en optimisant l’utilisation des ressources en eau, en favorisant la fertilisation naturelle via l’utilisation de composts végétaux et de fumier, ou encore en mettant en place une rotation des cultures afin de maintenir l’équilibre biologique des sols.
Nous portons une attention particulière au fait que les personnes qui rentrent dans le GIE sachent ce qu’elles veulent faire, aient des connaissances solides en agriculture, management et commerce avant de se lancer. Il faut bien retenir que le GIE n’est pas une franchise, il offre des ressources et des conseils à ses membres (ex. communication, centrale d’achat, techniques agricoles), mais il ne met pas à disposition des outils “clés en main” avec une assurance sur le nombre de clients ou le chiffre d’affaires, par exemple.
Autre point d’attention, nous nous assurons que les agriculteurs aient un bail agricole en leur nom pour éviter les risques d’expropriation et garantir la pérennité de l’activité dans le temps. En effet, pour qu’une cueillette atteigne un rythme de croisière il faut compter environ 5 à 7 ans.

Plusieurs cueillettes du GIE sont aujourd’hui associées à un marché de producteurs, diriez-vous qu’il est nécessaire de diversifier son activité pour assurer la pérennité de votre modèle ?
Initialement, le mode de fonctionnement des cueillettes était un système en libre-service. Mais tu sais, les agriculteurs sont aussi des personnes qui aiment entreprendre, et certains de nos membres ont diversifié leurs activités autour de la cueillette. Par exemple, plusieurs cueillettes sont adossées à des magasins de producteurs, voire à des restaurants (ex. Cueillette de Gally, Cueillette de l’Aragnon), ou sont ouvertes pour des visites scolaires et proposent des animations autour du verger. Ce type d’activités peut représenter une ouverture d’activité et la possibilité de rayonner auprès d’une clientèle différente. De plus, comme la cueillette en libre-service ferme d’octobre-novembre à avril, la diversification permet de rester ouvert sur d’autres activités ou événements ponctuels pour continuer à fidéliser la clientèle d’année en année. A noter que ces exemples de diversification sont des initiatives individuelles de la part des agriculteurs. Néanmoins, le GIE y est très attentif et aimerait peut-être explorer ces idées pour continuer à grandir à un rythme régulier.

Jean-Claude, en plus d’être le président du GIE Chapeau de Paille, tu es aussi un agriculteur avec un cueillette près de Rennes, peux-tu nous la présenter ? Selon toi en quoi ce modèle est unique ?
Alors oui, j’ai repris une cueillette d’une dizaine d’hectares il y a 10 ans dans la commune de Thorigné Fouillard, à 5 mins en voiture à l’est de Rennes (Ferme de la Reauté – Cueillette de Thorigné). Cette cueillette existait déjà depuis les années 1985, elle avait été mise en place par un ancien agriculteur-éleveur, très ingénieux d’ailleurs, en réponse aux difficultés économiques dûes à la crise de la vache folle. Il avait commencé d’abord avec un verger de pommes conduit de manière très traditionnelle, comme on fait en arboriculture, puis petit à petit il a ouvert son verger de pommes en cueillette ; de fil en aiguille, la cueillette s’est agrandie : d’abord des fraises, puis des fleurs … et plein de bonnes choses !
Dans le prolongement naturel de ce projet, j’ai ouvert un magasin de producteurs, le Verger de la Reauté, pour profiter de l’attrait de la cueillette. J’y vend mes propres produits mais aussi des produits laitiers, des fromages, du vin et du cidre d’autres producteurs autour. Aujourd’hui, avec tout mon périmètre d’activités, j’emploie environ 14 personnes toute l’année.
En général, nos clients peuvent faire jusqu’à 20 km pour venir dans nos cueillettes, mais selon le bassin de population de chaque territoire cette zone de chalandise peut s’agrandir. Dans tous les cas, il est nécessaire que les cueillettes soient à proximité des zones urbaines avec des densités assez importantes pour que notre modèle fonctionne. Par exemple, le fait que je me trouve à 6 ou 7 km de Rennes permet aux familles d’avoir un endroit agréable pour leurs loisirs. Les gens viennent chercher des produits pour remplir leur réfrigérateur certes, mais au-delà de ça, ils viennent aussi pour passer un bon moment, se reconnecter avec la nature et prendre du plaisir en cueillant leurs propres aliments. En plus, chaque cueillette est unique car ses caractéristiques dépendent aussi du paysage agricole dans lequel elle se trouve : en Bretagne, par exemple, c’est le bocage. Une autre illustration de cet ancrage des cueillettes dans leur territoire est qu’en plus de proposer les fruits et légumes de saison à forte demande (fraises, tomates, pommes, concombres, courgettes, etc.), chacune d’entre-elles met aussi en valeur des variétés régionales et traditionnelles de chaque légume, fruit ou fleur ; tu ne trouveras donc jamais les mêmes mêmes produits selon les cueillettes !
💡 L’avis de FoodBiome ?
Le GIE Chapeau de Paille développe des modèles de cueillettes à destination des populations des zones urbaines et périurbaines, tout en laissant la liberté à ses adhérents de développer d’autres activités associées. Ces lieux hybrides entre agriculture, commerce et loisirs permettent aux citoyens de se reconnecter à la nature, de les sensibiliser au bien-manger, et de mettre en avant la saisonnalité et la typicité de chaque territoire. Aujourd’hui, la transition alimentaire et agricole vers des modèles plus durables ne peut se faire sans embarquer la société civile toute entière dans ce processus ; les cueillettes représentent ainsi un bon moyen d’éveiller l’intérêt des citoyens au monde du vivant présent sur leur territoire. En ce sens, ces valeurs résonnent avec la mission de FoodBiome de restaurer le lien alimentation-territoire.






